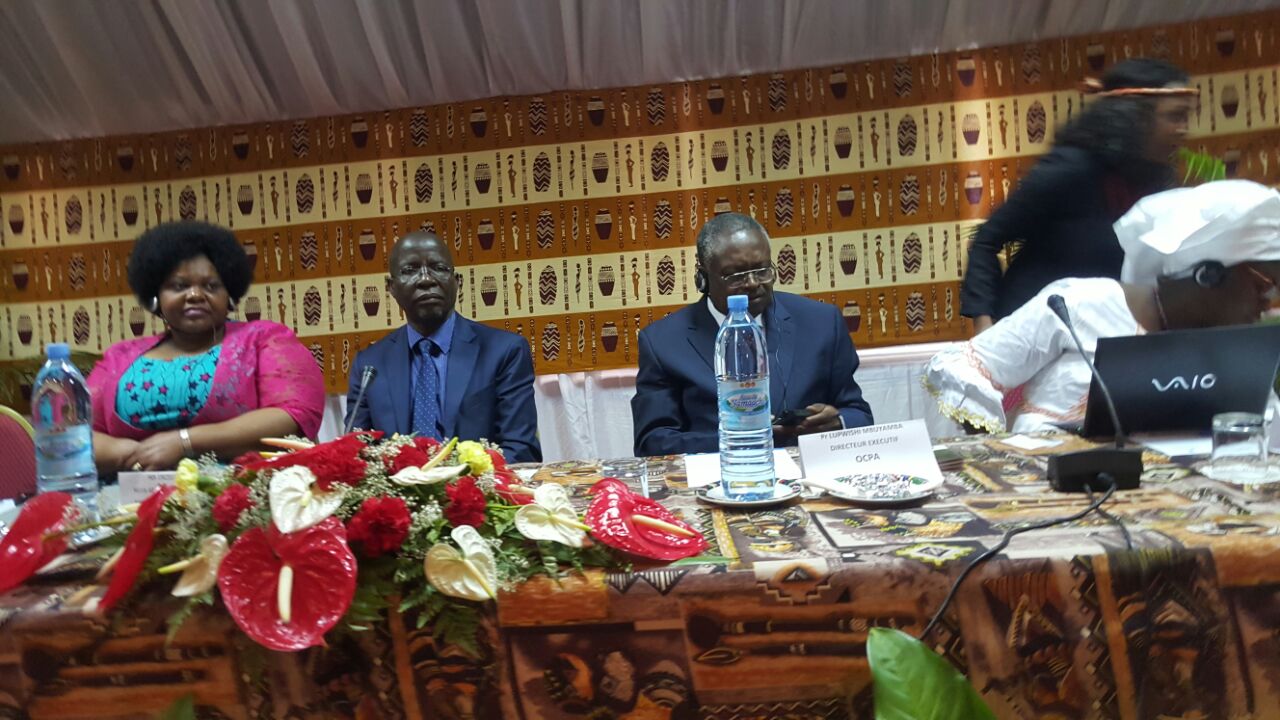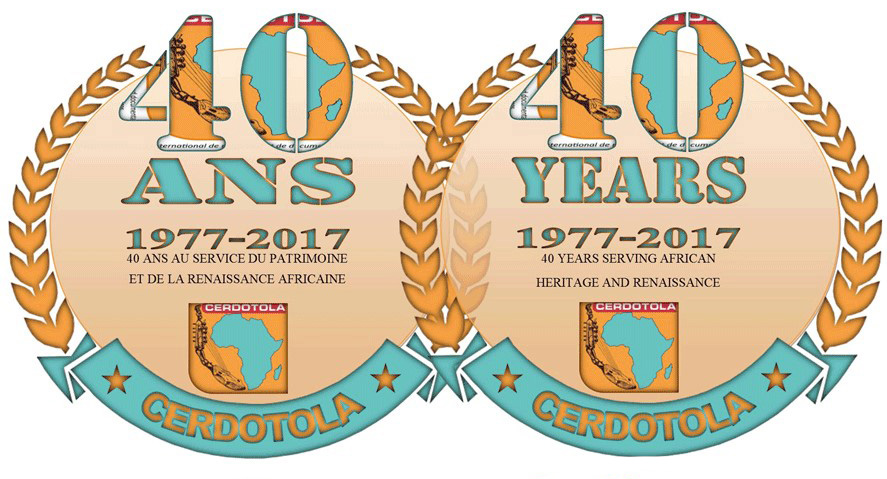Note d’orientation : Prof Alinah Segobye Prof à l’Institut de Leadership Africain Thabo Mbeki, UNISA, Pretoria.
Dans Note d’orientation intitulée «Exploiter la diversité de l'Afrique pour la Renaissance Africaine, l’unité et le développent - Continuer le dialogue pour les 50 années avenir et au-delà» l’oratrice a reconnu que la renaissance culturelle de l'Afrique est essentielle dans le processus d'émergence et de développement de l'Afrique. Elle a souligné que le désir de voir une Afrique unie et développée est présent chez tous africains y compris ceux de la diaspora et le rôle de la culture dans l'unification du continent et le développement a été reconnu par les dirigeants.
Les défis restent quant à l’exploitation du patrimoine riche et diversifié du continent et sur la façon dont l'unité de l'Afrique pourra se réaliser dans un monde globalisé a dit l’oratrice avant d’exprimer le souhait que cette réunion soit une opportunité d’ouvrir le débat au moment où la communauté mondiale revisite les Objectifs de Développement Durable (ODD) et la meilleure façon d'assurer leur mise en œuvre.
Session 1 : La charte
Modérateur : Charles Binam Bikoï
Marcel Diouf : La charte de la renaissance culturelle africaine : les origines et les objectifs
La naissance de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1963 à Addis Abeba a été suivie, treize ans après, par la Charte culturelle de l’Afrique en 1976, à Port Louis (Ile Maurice), puis à sa révision en 2006 par l’UA à Khartoum au Soudan. La Charte de la Renaissance culturelle est fille de nombreux débats et divergences des idéologies politico culturelles qui ont marqué le lendemain des indépendances. Entre Dakar et Alger, on a assisté à une floraison d’idéologies autour de la culture dont, la Negro renaissance dans le Nouveau Monde, le Consciencisme de Nkrumah peu connu, la Négritude, l’Africanité, l’African Personnality, l’Authenticité, l’Arabité, le Panarabisme et même l’Ethiopianisme des églises chrétiennes noires d’Afrique du Sud. Sans parler de la « Berbéritude » peut être en gestation. Le plus remarquable de toutes les idéologies fut celle de la Négritude des années 1930 qui définit la culture noire comme « l’ensemble des valeurs de civilisation du monde noir ». Après la tenue en avril 1966 à Dakar, du premier Festival mondial des Arts nègres, organisé par Léopold Sedar Senghor. L’Algérie sortant de sa lutte pour son indépendance développe un autre courant rivalisant ainsi Dakar. C’est pourquoi, trois ans après le festival de Dakar, l’Alger convoqua à son tour, sous l’égide de l’OUA cette fois, le premier Festival culturel panafricain d’Alger en 1969. Si Dakar, dans son idéologie privilégie l’Afrique et la Diaspora, Alger met l’accent sur l’Afrique et l’OUA.
En 1975, lors du 10e anniversaire de l’OUA, Dakar propose un projet de Charte qui fut amendé à la Conférence sur les politiques culturelles annonçant la naissance officielle des politiques culturelles en Afrique.
Sous cette charte s’est tenue la première conférence des ministres africains de la culture de l’OUA, en 1979, à Monrovia, le colloque sur le thème : Quelle Afrique en 2000 ? Et le congrès panafricain des hommes de sciences en 1987 à Brazzaville. En 1999, à Sirte en Lybie, au moment du changement de l’OUA à UA proposé par le Président Kadhafi, beaucoup d’initiatives ont été prises au plan purement culturel. En 2006, la conférence des ministres de la culture marque la révision de la Charte de 1976. La Charte pour renaissance culturelle africaine est adoptée en 2006 par les chefs d’Etat. C’est le premier document adopté par les chefs d’Etat et la représentation nationale, contrairement aux autres programmes.
Pour terminer Marcel DIOUF s’est demandé si on dirait, Charte culturelle pour la Renaissance africaine ou Charte africaine pour la Renaissance culturelle ?
Madame Angela Martins : Mise en œuvre de la charte de la renaissance culturelle : Bilan de la situation.
La Charte a été ratifiée par onze (11) États membres alors qu’il faut 35 soit les 2/3 pour son entrée en vigueur. Elle a présenté les freins à la ratification de cette charte et la nouvelle stratégie de sensibilisation basée sur les Champions. Les actions seront entreprises auprès du Conseil juridique pour que la charte puisse entrer en vigueur à l’obtention de 15 ratifications. Les Etats ayant déjà ratifié sont : (Angola, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Congo, Ethiopie Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud)
Résumé synthèse des enquêtes Hamaodou Mande
En prélude à la tenue du séminaire et pour nourrir les échanges qui auront lieu à cette occasion, un questionnaire a été adressé aux personnes et structures culturelles publiques et privées de différents pays africains en vue de recueillir des informations sur les obstacles à la ratification et à la mise en œuvre de la Charte.
Après dix (10) ans d’existence, seulement onze (11) des 54 Etats membres l’ont ratifié alors qu’elle a besoin de la ratification des 2/3 des membres pour entrer en vigueur.
Les enquêtes ont révélé que la Charte de la renaissance culturelle africaine n’a pas été suffisamment diffusée et qu’il n’existe pas, jusqu’à présent, une action conjointe des organisations de la société civile culturelle visant à soutenir l’effort des Etats afin de parvenir à la ratification et à la mise en œuvre de la Charte. Pour ce faire, il est impératif dans ce sens de travailler à renforcer les organisations culturelles africaines, à développer leurs capacités de coordination et de plaidoyer.
Session 2 : Expérience des pays
Modérateur : Rudo Sithole
Le Professeur Alinah Segobye a présenté des pistes de réflexions sur les mesures à prendre pour accentuer la participation des organisations de la société à vocation culturelle en vue de surmonter les problèmes et promouvoir la réalisation des objectifs culturels de la Charte et de l’Agenda 2063. Une participation de toutes les couches de la société pour un programme inclusif est recommandée.
CELHTO : Il a présenté l’Agenda dans le contexte de son Adoption par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) lors de la 24ème session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine qui a eu lieu à Addis-Abeba, du 30 au 31 janvier 2015. L’Agenda 2063 est destiné à inscrire définitivement l’Afrique dans une logique de compromis et de développement telle qu’elle a été définie, en 1963, lors de la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Il vise à : :
- planifier et organiser la trajectoire de développement de l'Afrique sur une base endogène et appropriée pour les 50 prochaines années en tirant profit des leçons apprises au cours des 50 dernières années ainsi que de l’expérience des précédents plans continentaux de développement (plan d’action de Lagos, Traité d’Abuja, NEPAD,
- s'appuyer sur les progrès actuels et tirer parti des opportunités stratégiques qui s’offrent à l’Afrique.
L’Agenda est une nouvelle étape pour le développement et l’intégration de l’Afrique.
LE FONDS POUR LE PATRIMOINE MONDIALAFRICAIN
Grace à un investissement efficace et une gestion durable, les sites du patrimoine mondial de l'Afrique seront des catalyseurs dans la transformation de l'image de l'Afrique et des moyens pour stimuler la croissance socio-économique et le développement des infrastructures au profit des populations africaines
• Le séminaire du patrimoine Harmoniser Agenda 2063 a eu lieu du 6 à 8 mai, 2015 à la Banque de développement de l'Afrique australe Midrand, Afrique du Sud.
• Axé sur l'ordre du jour de l'Union africaine a récemment publié 2063, qui trace les objectifs pour l'Afrique pour les 50 prochaines années. L'ordre du jour met en évidence 7 aspirations, dont on se réfère spécifiquement au patrimoine (no. 5).
• La pauvreté entoure la plupart des sites du patrimoine mondial en Afrique
• Des niveaux élevés de chômage
• Partenariat avec le secteur privé, les collectivités et le gouvernement inexistant
• Comment pouvons-nous les communautés locales voir le bénéfice du patrimoine?
Défis
• Nécessité pour le développement socio-économique
• Propriétés sur la Liste du patrimoine mondial en péril
• Gap dans la Liste du patrimoine mondial
• Ressources financières
• Collaboration avec les États parties
• Collaboration avec les institutions régionales et nationales du patrimoine en Afrique
• Poussée de la Stratégie
Projet de plan stratégique: Avril 2016 - Mars 2019
Session 3 : SICADIA
Modérateur : Rudo Sithole
Le SE du CERDOTOLA a présenté le processus allant de la rencontre de Lagos en 2007 en passant par la table ronde d’Alger et le 2eme Congrès culturel panafricain jusqu’à la rencontre de Yaoundé en 2009 qui a consacré l’Institutionnalisation du SICADIA en tant qu’instance de concertation et d’action au service de la politique culturelle de l’Union africaine et des politiques culturelles des Etats du content africain. La situation actuelle
Mme Ayeta Wangusa a proposé une structure permanente de coordination des activités du SICADIA
La mise en œuvre de la stratégie SICADIA
La stratégie sera coordonnée par la Commission de l'UA et par OCPA agissant comme un relais mise en œuvre
La répartition des tâches sera assurée en fonction des compétences et des capacités des partenaires de mise en œuvre;
La stratégie visera à promouvoir des partenariats fondés sur l'avantage mutuel et la complémentarité des efforts
La stratégie cherchera à promouvoir la mobilisation de tous les partenaires et l'intégration de tous les efforts qui contribuent à la réalisation des conclusions de la Table ronde à Alger.
Modalités et mécanismes de mise en œuvre de la Stratégie
Pour une mobilisation efficace des efforts et des compétences, la mise en œuvre de la stratégie sera suivie par un groupe de contact comprenant les organisations suivantes en charge de la promotion de la coopération à
Recherche - ACALAN (Bamako, Mali);
Industries culturelles - Afrique créative (Nice, France); politiques culturelles OCPA - (Maputo, Mozambique)
Nécessité d'inclure l'organisation culturelle de l'Afrique anglophone
Session 4 : Formulation de la stratégie
Modérateur : Manda Tchebwa
Le représentant de l'Académie Africaine des Langues (ACALAN), a présenté les activités de l’ACALAN par rapport à la Charte Révisée de la Renaissance Culturelle Africaine.
Montrant la centralité des langues dans la Charte, il a dit que l’une des fonctions principales de l’ACALAN est de plaider pour la ratification et la mise en œuvre de la charte. L’Union africaine a ordonné toutes ses institutions spécialisées de la culture et des langues de participer vivement à la promotion de la charte. L’ACALAN va continuer à collaborer avec toutes les institutions de la culture et des langues pour assurer la promotion de la culture et langues ainsi que celle de la charte.
- Stratégie de promotion du cinéma par Désiré YAMEOGO FESPACO
Le FESPACO est un important cadre de concertation qui mobilise 500 professionnels africains et de la Diaspora au tour des thèmes comme : la production, la circulation et la production du cinéma en Afrique. Les problèmes du cinéma africain sont les mêmes dans presque tous les pays à savoir : absence de financement local, absence de circuits de diffusion du cinéma et de salles, etc. autant d’écueils qui demandent davantage efforts et engagement. En accord avec la Fédération Panafricaine du Cinéma – FEPACI, le Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou- FESPACO œuvre à trouver des solutions à ces questions.
- Stratégie de promotion de la formation par KIDIBA Samuel EPA
Face au déficit en spécialistes dans différents domaines du patrimoine l’Ecole du Patrimoine Africain- EPA porte sur deux axes :
- les séminaires, ateliers organisés à l’EPA dont le siège est Porto Novo au Benin ou dans les pays qui les demandent ;
- La licence en sauvegarde et valorisation du patrimoine (Muséologie, archives, documentation, bibliothèque, tourisme culturel) arrimée, au système LMD (Licence Master et Doctorat), se fait en deux ans. Les enseignants viennent du continent et d’autres pays d’Europe, et les participants sont des pays francophones, lusophones et hispanophones. Le niveau baccalauréat et l’expérience sont les critères d’admission à ladite licence. L’Université d’Abomey Calavi – UAC au Benin et l’Université de Paris 1 Sorbonne en assurent le niveau académique. Après des cours de tronc commun, les participants choisissent leur spécialité, selon le thème de la soutenance. Le financement vient des pays des participants et des partenaires de l’EPA dont la Fondation Getty. Il assure à chacun un logement, une bourse et une assurance maladie. La contribution d’un participant à cette licence est environ de 7000.000 f CFA soit 14.000 dollars US. Tenant compte de la Charte, l’EPA se propose d’assister les pays sur la formation, des jeunes, des femmes et des Forces de Défenses et de Sécurité-FDS. C’est dans le but des protéger le patrimoine en temps de guerre, en plein conflits ou après.
- Stratégie de promotion du livre par Abdoulaye Fodé Ndione Président d’Afrilivres
- Regroupement de 33 maisons d’éditions de 13 pays
- Professionnaliser le secteur de l’édition
- Donner de la visibilité à la création littéraire, aux écrivains, aux éditeurs-membres, à travers le site web, et avec d’autres outils de communication.
- Assurer une bonne circulation du livre à travers des réseaux de librairies, des bibliothèques, des prescripteurs, des diffuseurs, des structures diverses, des salons et foires du livre.
- Développer les partenariats
- Relever le défi numérique
- Promouvoir les Langues africaines, accompagner la création littéraire en langues africaines, éditer toute langue codifiée, reconnue comme langue de communication. Renforcer la circulation des livres édités en langues africaines transfrontalières.
- Stratégie de promotion des Arts plastiques et artisanat R. SENGHOR, Renaissance Africaine
Il s’agit d’un secteur dynamique qui contribue à la création des richesses et de l’emploi, mais le secteur est confronté à des problèmes de plusieurs ordres à savoir :
- Insuffisance ou inexistence des infrastructures comme les musées, les galeries, les industries culturelles ;
- insuffisance de budgets ;
- manque de réflexion sur le secteur entrainant la routine ;
- déficit sur le statut des artistes et des artisans ;
- absence des statistiques sur les artistes, les artisans, les arts, des droits d’auteur, droits voisins.
- C’est pourquoi pour arriver à une optimalisation de ce secteur, il faut arriver à :
- La formation et à la sensibilisation des acteurs sur la Charte, en y intégrant le numérique, la législation ;
- la mise en place d’un plan d’action en d’ plaidoyer sur les arts et l’artisanat ;
- la coordination pour un suivi du SCADIA.
Strategie de promotion du théâtre par Hamadou Mandé OCPA
Le théâtre peut servir la promotion de la charte et plus largement de la renaissance culturelle africaine. Car il est un moyen d’éducation populaire, d’information et de sensibilisation et de vulgarisation des objectifs de la charte en Afrique et au niveau de la diaspora.
Stratégie de promotion de la Musique par Manda Tchebwa CICIBA
L’Afrique avec 54 pays correspondent a 54 aires culturelles musicales, 54 personnalités différentes avec parfois des aires communes :
- Musique traditionnelle : anonyme, sans auteur, sans éditeur, sans support matériel sans valeur marchande ;
- musique urbaine : bruit de ville, de l’homme policé, esthétique codifiée, vendue, enregistrée, etc.
- musique de la Diaspora : jazz, tango, rumba, merengue.
Défis d’aujourd’hui : métier de producteur mort, musiciens devenus auto producteurs, piraterie rampante, cyber piraterie, télé-copiage des œuvres,
Que faire ? Étudier les conditions de reconversion a l’informatique, clé USB support anti-piraterie ? YouTube, Face book, monétarisation informatique.
Marché numérique : CD, DVD, VCD, Blue -Ray, HD, Walkman, MP3, IPAD …
- A l’horizon 2030: L’industrie musicale dans sa forme actuelle disparaitra. L’Afrique représente à peine 0,4 pour cent du marché mondial. L’enrichissement musical est de l’ordre numérique. Il faut s’y préparer dès aujourd’hui.
Introduction en vue de la formulation d’une stratégie et d’un plan d’action pour harmoniser la contribution de la société civile professionnelle dans l’appui à apporter aux efforts entrepris par les Etats pour la mise en œuvre de la charte par Hamadou Mandé.
La stratégie permettra d’atteindre les résultats attendus qui s’articulent sur trois axes : compréhension des problèmes, identification des actions possibles à prendre et la disponibilité d’un document stratégique de mise en œuvre de la Charte. Les fondements et la pertinence de la stratégie s’appuient sur des conclusions des réunions précédentes ayant jeté les bases d’un continent qui se verra désormais autrement. La politique, la communication/ l’accessibilité de l’information, l’économie et finances, la Société civile culturelle, les Ressources humaines la sécurité sont les domaines d’actions possibles.
Le Plan d’action est triennal, quant à la stratégie qui s’étalera sur quatre ans, a pour vision le développement d’une campagne d’action massive et une pertinence conduisant à l’accélération de la ratification, par les Etats membres, de la Charte en vue de son entrée en vigueur et de sa mise en œuvre généralisée. Elle s’appuie sur la Charte elle-même, sur les conclusions des trois premiers SICADIA ainsi que sur l’Agenda 2063 de l’UA.
Les objectifs de la stratégie sont les suivants :
- Renforcer les capacités des organisations de la société civile culturelle :
- Renforcer le leadership des institutions et organisations culturelles dans l’action de promotion de la charte et de l’Agenda 2063
- Renforcer la gouvernance et le dialogue par l’implication des populations
- Promouvoir la jeunesse pour en faire un acteur essentiel de la valorisation et de la promotion des objectifs de la Charte et de l’Agenda 2063.
En fonction des enjeux les institutions membres des SICADIA pourront affirmer des situations relatives à leurs champs d’interventions à la fois pour la ratification ainsi que sur mesures collectives à prendre au besoin du développement des filières culturels.
Une stratégie basée sur une proposition de renforcement du SICADIA comme cadre de concertation et d’échanges Un renforcement des Institutions culturelles au sein du SICADIA orienté vers les centres d’intérêt commun La CICADIA et le SICADIA développent un travail de plaidoyer autour des filières
Renforcer et renouveler autour de la SICADIA des stratégies communes
Session 5 : Adoption de la stratégie et plan d’action
Modérateur : Marcel Diouf
Revivez les événements en images